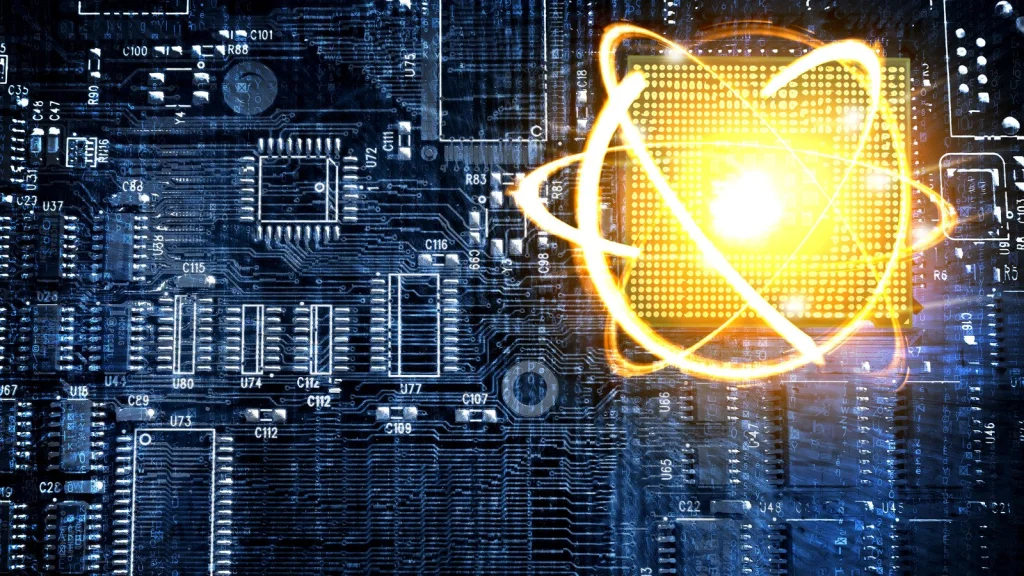Si vous laissez une chaise dans une pièce et que vous sortez, cette chaise existe-t-elle encore ? Beaucoup répondraient instinctivement « Bien sûr que oui ! », comme si l’existence d’un objet ne dépendait pas de notre observation. Et que dire de l’arbre proverbial qui tombe en forêt ? Fait-il du bruit s’il n’y a personne pour l’entendre ?
La réponse surprenante est : non, il ne fait pas de bruit. Le son, comme toutes les informations sensorielles, résulte de l’interaction entre un corps et son environnement. C’est une propriété émergente, à l’instar de la conscience. Un arbre qui tombe génère une onde captée par l’oreille, mais le son n’existe pas indépendamment de notre neurochimie et de notre cerveau. Cette réflexion prépare à appréhender la mécanique quantique, dont la nature de la réalité devient de plus en plus ambiguë.
Longtemps, avant les manipulations actuelles du terme « quantique » dans la science-fiction ou les avancées techniques comme les ordinateurs quantiques, des traditions comme le taoïsme ou le bouddhisme zen décrivaient l’univers comme une entité indivisible. Empiristes tels qu’Aristote, Hume ou Locke enseignaient que la réalité observable était la vérité ultime. Aujourd’hui, ces philosophies millénaires, la neuroscience moderne et la physique quantique convergent vers une même conclusion paradoxale : tout existe et n’existe pas simultanément.
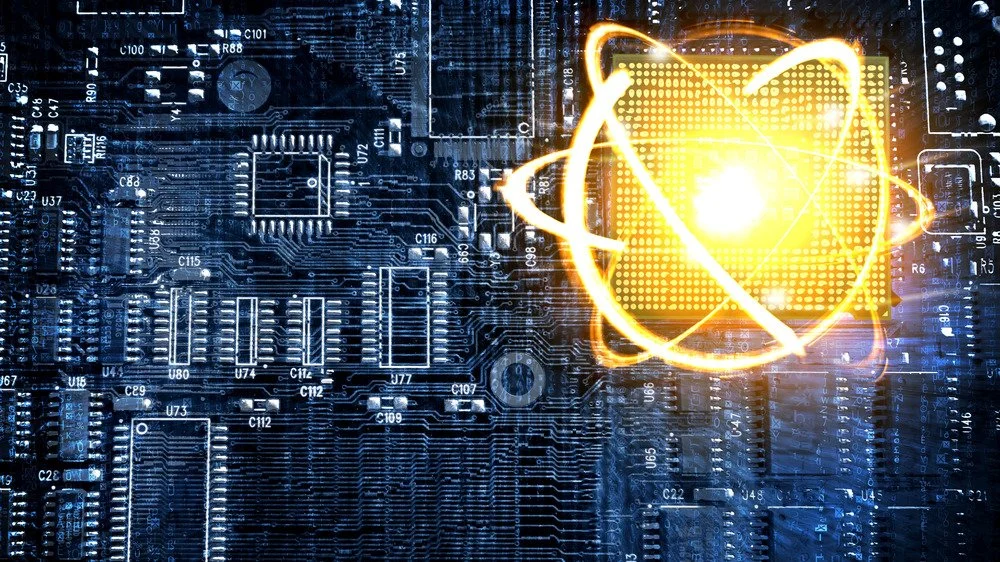
Un classique pour introduire la mécanique quantique est le paradoxe du chat de Schrödinger. Formulé en 1935 par le physicien autrichien Erwin Schrödinger, ce modèle illustre les contradictions entre la physique classique, déterministe et la mécanique quantique. Une particule subatomique ne peut avoir une position et une vitesse simultanément définies, et sa réalité n’est connue qu’au moment de la mesure. Le chat, enfermé dans une boite exposée à une source radioactive, est à la fois mort et vivant tant que la boite reste fermée.
La physique classique ne s’applique pas à l’échelle atomique, où les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément – un phénomène appelé superposition. Cette indétermination fut contestée par Einstein, qui demanda si la lune cesse d’exister quand on ne la regarde pas, défendant l’idée d’une réalité indépendante de l’observation. Pourtant, la mécanique quantique, à travers des expériences modernes, montre qu’à cette échelle, la réalité est non déterministe et peut dépendre du point d’observation.
C’est notamment ce que démontre l’expérience du « problème de l’ami de Wigner », pensée en 1961 et testée en 2018, où des photons intriqués émis de deux lieux différents ont donné des résultats contradictoires. Cette expérience met à mal la notion d’une réalité objective et universelle, montrant que ce qui est vrai pour un observateur ne l’est pas forcément pour un autre.

En résumé, la mécanique quantique nous invite à repenser notre conception de l’existence. Rien ne semble exister isolément, et la réalité elle-même apparaît comme un réseau complexe d’interactions et de perceptions. Ce constat résonne aussi bien avec les anciennes sagesses orientales que les découvertes scientifiques contemporaines, suggérant que l’univers est une conscience unifiée, en perpétuelle évolution.