Les Règles de Condamnation à Mort les Plus Étranges de l’Histoire
Nous sommes en 1386 et vous êtes un Français dans la ville normande de Falaise. Un procès pour meurtre très médiatisé, impliquant un assassin assez cruel pour tuer un jeune enfant, touche à sa fin. Alors que vous êtes assis dans la salle d’audience, le juge prononce la sentence : le prévenu doit être pendu. Le seul problème ? Le prévenu est un cochon.
Ceci n’est pas un film absurde — c’est un véritable procès illustrant à quel point l’administration de la peine de mort — quelque chose que les gens considéraient comme une donnée dans le passé — a été loin d’être simple et parfois carrément étrange. Étant donné la fascination morbide des humains pour la mort — surtout lorsqu’elle devient un rituel public — il n’est pas surprenant que la peine capitale ait développé toutes sortes de règles et de coutumes qui n’ont guère de sens pour les audiences occidentales modernes.
Néanmoins, rappelons la barrière de Chesterton : si une tradition ancienne existe, c’est probablement pour une raison. Il en va de même pour les règles parfois byzantines entourant la peine capitale; elles avaient un sens dans leur contexte historique et social — parfois pratiques, d’autres fois rituelles, peu importe combien elles puissent sembler repoussantes aujourd’hui. La seule constante est leur brutalité souvent implacable.
Demander pardon

Malgré leur part de punitions cruelles et inhabituelles, les sociétés médiévales et de la Renaissance ont tenté d’atténuer l’impact de la peine de mort en la transformant en un rituel « humain » christianisé. Cela impliquait de rassembler le bourreau et le condamné pour un dernier verre et une demande de pardon.
L’exécution de Hans Vogel dans la Nuremberg du XVIe siècle, relatée dans le livre de l’historien Joel Harrington, « The Faithful Executioner », reproduite dans Slate, illustre le rituel élaboré — et parfois étrange — qui s’est développé autour de la peine capitale. Les derniers jours du condamné n’étaient pas très différents de ceux d’un détenu dans le couloir de la mort aujourd’hui. Il pouvait recevoir sa famille, bénéficier de réconfort spirituel, avoir un dernier repas et une boisson, et confesser ses péchés dans l’espoir d’entrer au paradis. Mais au moment de mourir, sa dernière rencontre serait avec le bourreau, qui entrait dans la cellule du condamné — idéalement ivre — vêtu de ses plus beaux habits.
Une fois dans la cellule, le bourreau demandait pardon au détenu pour ce qu’il s’apprêtait à faire. Ils engageaient alors une conversation — ou du moins essayaient — pour vérifier si le prisonnier était prêt pour l’exécution. Sinon, ils partageaient un « Saint John’s Drink », célèbre analgésique, avant de se rendre au site d’exécution. Si le bourreau se montrait clément, il pouvait permettre au condamné de prendre un objet de réconfort avec lui lors de l’exécution.
Procès d’animaux

Nous sommes en 1457. Une truie et ses six porcelets terrorisent la ville française de Savigny, attaquant des personnes et tuant un garçon de cinq ans. Selon JSTOR, au lieu de faire face à des responsabilités, le propriétaire des porcs échappe à la justice, laissant les animaux subir un procès pour meurtre. La truie est reconnue coupable et condamnée à la pendaison. Les porcelets sont acquittés faute de preuves de leur implication.
Cela semble inconcevable à nos oreilles modernes, mais ce genre de chose s’est réellement produit, et pas seulement à Savigny. En 1386, une autre truie a été exécutée pour des raisons similaires dans la ville normande de Falaise. Lors de ces procès d’animaux, les accusés étaient jugés pour des crimes comme le meurtre, à la façon des humains, bien qu’ils ne puissent pas se défendre parce qu’ils étaient, après tout, des animaux. Ainsi, lorsque la truie de 1386 a été exécutée, elle a été habillée en vêtements humains, escortée par des gardes armés et pendue par un bourreau professionnel.
Fait surprenant, les procès d’animaux pour des activités démoniaques étaient rares, probablement parce que l’Église catholique médiévale ne poursuivait généralement pas les affaires de sorcellerie. En général, les gens traitaient ces affaires par eux-mêmes, comme lors de l’extermination des chats noirs pendant les épidémies de peste. Des cas comme celui de l’exécution du coq de Bâle faisaient exception. Ce coq a été exécuté pour avoir pondu un œuf censé éclore en basilic (à l’instar de celui d’Harry Potter).
Donner un pourboire au bourreau pour une mort moins douloureuse
À travers l’Europe, surtout en France avant la Révolution, l’exécution variait selon la classe sociale. Les roturiers subissaient quelques-unes des méthodes d’exécution les plus douloureuses comme brûlées, pendues ou « rouées » — une punition atroce qui consistait à écraser les os du condamné avant de le menacer à travers les rayons d’une roue avant de le poignarder. Les aristocrates étaient également techniquement soumis à de telles punitions. Mais même au seuil de la mort, l’argent parlait. Parmi les règles non écrites de l’exécution, les riches avaient la possibilité de « donner un pourboire » au bourreau pour obtenir une mort moins douloureuse par décapitation. Pendant la Révolution française, les révolutionnaires ont déploré ce fait et ont décidé d’égaliser les choses en inventant la guillotine, qui soumettrait tous les condamnés à une mort rapide par décapitation.
Bien que l’Europe ait abandonné les formes d’exécution les plus brutales au XIXe siècle, la pratique de donner un pourboire aux bourreaux n’a pas disparu, surtout dans le contexte des pelotons d’exécution. Au moins un exemple de cela existe en 1867, lorsque l’empereur Maximilien du Mexique a affronté le peloton d’exécution aux mains des républicains mexicains de Benito Juarez. Selon le Met Museum, il a donné de l’or à ses bourreaux pour obtenir une mort plus digne en évitant que l’on ne lui tire dans le visage. Il est difficile de savoir ce qui s’est réellement passé, mais étant donné la fréquence de cette pratique parmi les nobles européens, il n’y a aucune raison de penser que ce ne soit pas vrai.
La Loi de Fratricide
Imaginez une loi qui impose régulièrement la peine de mort — pas seulement de manière occasionnelle — à un groupe de personnes simplement pour exister. C’est ainsi que fonctionnait l’élite de l’Empire ottoman, où tous les prétendants masculins à la Sublime Porte étaient de facto condamnés à mort sous la Loi de Fratricide.
L’Empire ottoman avait un point faible qu’aucune armée ne pouvait contrer : la pratique de la polygamie des sultans. Les vastes harems ottomans donnaient naissance à de nombreux successeurs potentiels au trône, entraînant des crises de succession à chaque décès d’un sultan. Au lieu d’instituer une loi de succession claire, Mehmet II, dont le premier acte fut de tuer son frère nourrisson, fit passer la Loi de Fratricide. Cette législation exigeait légalement que les héritiers du sultan se battent et tuent tous leurs frères, oncles et cousins ayant des prétentions au trône jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul homme.
La loi était brutale et sa logique simple : pas de remplaçants, pas de guerre civile ni de troubles internes. Ce combat à la manière des Hunger Games garantissait que les hommes les plus impitoyables et sadiques devenaient sultans — des hommes prêts à maintenir l’Empire ottoman diversifié et fractionné uni et à sécuriser leur position par tous les moyens nécessaires. Brutal aux yeux occidentaux, mais dans le contexte dangereux de la Renaissance, cela avait du sens d’un point de vue purement réalpolitik.
Les lois aztèques sur l’alcool ne faisaient pas de distinction
Généralement, plus on a de l’argent, plus on peut échapper aux conséquences de ses actes, surtout en matière criminelle. Même le célèbre code de lois d’Hammourabi accordait aux nobles des exemptions pour certains crimes capitaux commis par des roturiers. En Amérique, toutefois, les choses étaient très différentes.
La loi aztèque sur l’ivresse publique en est l’illustration parfaite. L’Empire aztèque contrôlait strictement la consommation d’alcool. Seules les personnes âgées pouvaient boire librement et apparaître encore en public — cela était même encouragé lors de certaines cérémonies. Pour les autres, l’alcool était pratiquement interdit aux roturiers, tandis que les élites pouvaient boire en quantités limitées. Cependant, appartenir à la classe dirigeante n’était pas une excuse pour violer la loi. L’ivresse publique était un crime passible de mort pour toute personne de moins de 70 ans — sans distinction. Nobles et roturiers surpris en état d’ivresse en public avaient droit à une seconde chance, mais les récidivistes étaient exécutés.
La logique aztèque derrière la punition égale des nobles et des roturiers reposait sur la conception impériale de la noblesse. En tant que classe éduquée et futurs dirigeants de l’empire, les nobles devaient être des modèles de vertu et de conduite publique — en somme, ils devaient prêcher par l’exemple. La seule différence résidait dans le mode d’exécution : les roturiers étaient battus en public, tandis que les nobles et leurs familles étaient épargnés de la honte par une strangulation privée.
Le Catch-22 de la justice Dakota
Un système de justice efficace punit idéalement les méfaits au lieu de les encourager. Chez les Dakota du Midwest supérieur, cependant, punir le crime de meurtre n’était guère simple, en raison d’un Catch-22 de soi qui mettait l’honneur familial en conflit avec la justice.
En tant que culture non lettrée, les Dakota et la plupart des autres tribus indigènes d’Amérique du Nord n’avaient pas de codes juridiques écrits. La justice était souvent rendue par des anciens ou réglée entre les familles des parties impliquées dans un conflit. En raison de ce système, les querelles entre familles Dakota — en particulier celles impliquant un meurtre — pouvaient souvent dégénérer. Après un premier meurtre, la coutume dictait que la partie lésée cherche à se venger, ce qui finissait souvent par une série de meurtres vengés, amassant plusieurs corps et créant d’autant plus de meurtriers à venger.
Finalement, les anciens se lassaient de ces tueries incessantes et négociaient entre la famille du meurtrier et celle de la victime. La famille du meurtrier consentait alors à remettre l’accusé à la famille de la victime. Si le meurtrier initial était déjà mort à la suite d’une vengeance, celui qui avait commis la dernière vengeance était remis à la famille des victimes à la place. Cette famille pouvait alors décider de le tuer ou de le libérer. Cette méthode visait peut-être à dissuader les vengeances — quiconque exécutait la vengeance devenait un candidat à l’exécution ; un véritable Catch-22 s’il en est.
Parmi les Inuit, les membres de la famille exécutaient les sentences

Les Inuit nomades de l’Arctique n’avaient pas de concept de loi ou de justice rétributive comme les sociétés sédentaires d’Europe, d’Asie ou de Mésoamérique. Le crime était principalement défini en fonction de l’impact perçu sur la survie du groupe. La punition était appliquée selon le niveau de perturbation, ce que l’Alberta Law Review qualifie de « maintien de la paix ».
Certaines infractions étaient jugées si nuisibles à la survie collective qu’elles entraînaient généralement une exécution. Parmi celles-ci figuraient le meurtre en série (les meurtres isolés pouvaient être excusés au nom de l’harmonie du groupe), le mensonge en série, le vol en série, la maladie mentale et la sorcellerie. D’autres « crimes » liés à la survie du groupe incluaient le fait d’être un enfant supplémentaire non désiré (généralement une fille), d’être âgé ou gravement malade. La justice inuite était à la fois étrange et extrêmement cruelle selon les standards modernes.
Selon la coutume inuite, les exécutions étaient réalisées par les proches des condamnés. Cette pratique devait être incroyablement difficile — imaginez une mère contrainte d’abandonner sa fille ou un homme obligé de tuer un parent âgé. Cependant, dans une société où la survie collective était primordiale, ces règles avaient un sens. L’unité était essentielle dans l’Arctique rude; des conflits internes pouvaient signer la fin du groupe et de tous ses membres. En confiant l’exécution aux personnes les plus proches du condamné, on évitait les vendettas.
Au Japon, les exécutions sont rapides, inattendues et parfois sans appel

En France et dans d’autres pays comme les États-Unis, les détenus dans le couloir de la mort reçoivent souvent un accompagnement spirituel, des visites de proches, un dernier repas et sont prévenus de leur exécution bien avant qu’elle ne se produise. Les opposants à la peine de mort argumentent que cette longue attente, souvent passée à plaider pour la clémence, constitue une forme de torture psychologique. Le Japon, en revanche, a résolu ce problème en rendant les exécutions soudaines et inattendues.
Les exécutions au Japon obéissent à un ensemble de règles différent de celui que l’on peut voir aux États-Unis. Alors que ces dernières sont principalement effectuées par injection létale ou par gaz, au Japon, elles sont réalisées par pendaison. Bien qu’il soit possible de faire appel d’une sentence capitale, l’exécution peut toujours être effectuée même si un nouveau procès est en cours. Les condamnés apprennent généralement leur sort le matin de leur exécution, et leurs familles ne sont informées qu’après coup via un communiqué de presse du ministère de la Justice.
Les opposants à la peine de mort accusent le Japon de torturer mentalement les détenus en leur annonçant leur exécution de manière inattendue et à court préavis, sans la possibilité pour eux d’avoir des proches pour les soutenir. Le Japon, cependant, défend cette pratique en la qualifiant d’acte de miséricorde envers les condamnés, qui éviteraient ainsi de vivre avec la terreur constante de l’attente d’une mort imminente.
Les lapidations dans l’Israël ancien étaient des affaires communautaires
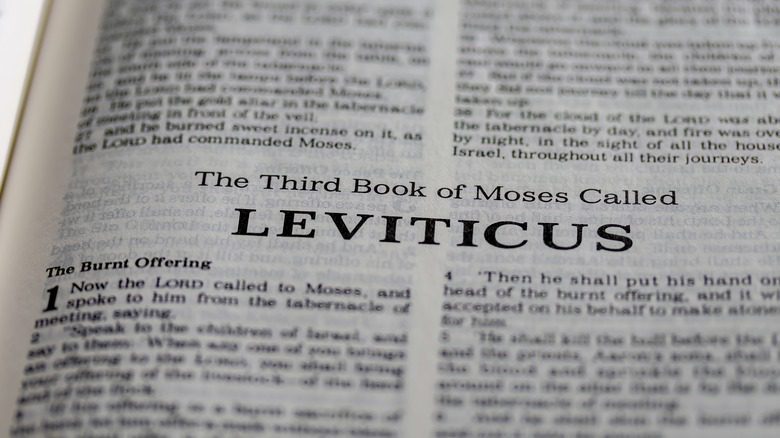
Les érudits pensent que les lois de l’Israël ancien proviennent des trois codes législatifs conservés dans le Pentateuque, ou les cinq premiers livres de la Bible. Si tel est le cas, la lapidation était la peine la plus courante pour une série d’infractions, allant de l’adultère, l’idolâtrie, le blasphème et la violation du Sabbat.
Le Lévitique 24:16 précise que de telles exécutions étaient des affaires communautaires : « Toute la communauté devra lapider cette personne » pour blasphème au nom de Dieu, avec les témoins lançant les premières pierres. La raison de cette loi repose sur la pureté et l’expiation collective. La commission d’un péché grave apportait impureté et culpabilité sur la famille et la communauté de cette personne. En participant à l’exécution du pécheur, la communauté se purgeait de la culpabilité et de l’impureté.
Dans les cas d’adultère concernant les jeunes mariées non vierges (le viol étant exclu) lors de leurs nuits de noces, le Deutéronome 22:21 demandait aux hommes de la communauté de lapider la femme coupable à l’entrée de la maison de son père. Là encore, la logique voulait que l’exécution à cet endroit « purge ainsi le mal de [leur] milieu » et restitue l’honneur et la pureté à la maison familiale.
On ne sait pas clairement comment les lois séculaires dérivées de cette législation fonctionnaient en pratique, car aucun dossier juridique ou statut de l’Israël ancien n’a survécu. Cependant, il est raisonnable de supposer que si le Pentateuque, dont l’origine est attribuée à Dieu lui-même, existait déjà au 10ème siècle av. J.-C., ses règles auraient été reflétées dans les sanctions de l’époque — même si ce n’était pas parfaitement.
Les exécutions secrètes de Venise
À l’époque de la Réforme, la République de Venise se trouvait face à un dilemme. Il lui fallait imposer le catholicisme tout en préservant sa réputation de tolérance, essentielle pour les affaires, peu importe la religion. Cette nécessité économique provenait en partie de ses relations avec l’Europe protestante et une communauté juive influente, cruciales pour le commerce avec le monde méditerranéen sous domination musulmane.
Selon l’historien John Martin dans « Venice’s Hidden Enemies », La Serenissima appliquait l’adage « si personne ne le voit, cela n’a pas eu lieu ». Contrairement aux exécutions publiques de l’époque de la Renaissance utilisées comme moyen de dissuasion, Venise évitait les exécutions publiques des hérétiques. Toutefois, lorsque l’exécution était inévitable, celles-ci étaient menées secrètement. Un petit groupe d’officiels et de prêtres emmenait les condamnés dans la lagune avant l’aube, les lestait d’une pierre, priait pour eux, puis les précipitait dans l’eau. Aucun corps, aucun témoin, aucune preuve. Aux yeux du doge, le condamné avait simplement disparu sans laisser de trace.
Ces exécutions secrètes permettaient à Venise d’affirmer à ses partenaires protestants, sincèrement, qu’aucune persécution n’avait lieu envers ceux qui ne suivaient pas le catholicisme. En parallèle, elle pouvait dire le contraire au pape et envoyer un avertissement aux hérétiques potentiels : s’ils allaient trop loin, ils risquaient de disparaître sans laisser de trace.
Sorbet et courses à la cour ottomane
Alors que les membres de la famille impériale ottomane étaient soumis à la Loi du Fratricide, les exécutions officielles des non-royaux étaient nettement plus ritualisées. Selon l’historien Godfrey Goodwin (via Smithsonian), les exécutions étaient annoncées par les jardiniers en chef du sultan. La victime potentielle était convoquée. « [I]l devait mordre sa lèvre à travers les courtoisies de l’hospitalité avant, enfin, de recevoir une coupe de sorbet. Si elle était blanche, il soupirait de soulagement, mais si elle était rouge, il tombait en désespoir, car le rouge était la couleur de la mort. » Les membres du corps d’élite des janissaires tuaient ensuite l’infortuné. Une erreur politique pouvait provoquer l’ire du sultan, et les bureaucrates ottomans redoutaient ce rituel.
Pour les hauts fonctionnaires, en particulier le grand vizir, il y avait une chance d’échapper à l’horrible sorbet rouge. Si le fonctionnaire pouvait battre le jardinier qui lui était assigné lors d’une course à pied, il pouvait éviter l’exécution. Cette coutume a perduré jusqu’au 19e siècle, la dernière instance enregistrée étant la victoire du Grand Vizir Halil Pacha. Cet homme, dont le prédécesseur a été exécuté neuf jours seulement après sa nomination, a gagné sa course et obtenu une fonction de gouverneur à Damas.
Les exécutions mongoles ne devaient pas faire couler de sang
La « Histoire secrète des Mongols », une biographie du XIIIe siècle de Gengis Khan, raconte qu’à ses débuts dans la steppe mongole, il avait capturé deux chefs qui avaient trahi leurs serments envers lui. Ces derniers, s’attendant à une fin sanglante par égorgement, furent étonnés lorsque Gengis Khan ordonna leur suffocation. Cette méthode d’exécution semblait contredire le modus operandi habituel des Mongols, qui laissait souvent une traînée de destruction et de morts sanglantes derrière eux.
Il semble que les Mongols n’hésitaient pas à verser du sang lorsqu’il s’agissait de tuer des gens ordinaires, mais se conformaient à d’autres règles lorsqu’ils exécutaient des nobles. Par exemple, Hulegu Khan fit rouler dans un tapis le calife abbasside Al-Mu’tasim avant de le faire piétiner à mort par des chevaux lors du sac de Bagdad en 1258. De même, le gouverneur khwarezmien Inalchuq fut exécuté en faisant couler de l’argent fondu dans sa gorge. Selon le traducteur Urgunge Onon, les Mongols, superstitieux en ce qui concerne le sang noble, préféraient employer d’autres méthodes, souvent en piétinant leurs victimes.
Il est difficile de savoir pourquoi les Mongols avaient cette superstition. Une hypothèse est que cela permettait de donner aux nobles une mort digne, bien que pas nécessairement moins douloureuse.








